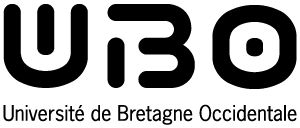Cette conférence sera suivie d'un séminaire sur "Recherche en linguistique et milieu entrepreneurial".
M. Mohamed Ismail Abdirachid, Maître de Conférences à l'Université de Djibouti, est spécialiste en Sciences du Langage et membre de l'Institut de Recherche Indépendant de la Corne de l'Afrique (IRICA).
« Langues coloniales et langues locales : défis didactiques à l’heure actuelle »
Je propose une thématique, avec possiblement une double articulation. En effet, je suis particulièrement interpellée par la thématique de la temporalité et de la matérialité, qui entre en résonance avec mes travaux sur la culture, la mémoire et la transmission. Ces deux dimensions – loin d’être neutres – sont profondément culturellement construites, et leur compréhension varie selon les sociétés. Ce qui m’intéresse, c’est l’écart que peut générer une conception différente de la temporalité : lorsqu’on ne pense pas le temps de manière linéaire, continue ou progressive, cela produit des malentendus profonds dans les interactions interculturelles, les systèmes éducatifs, ou encore dans le monde de l’entreprise. Cet écart agit sur la manière de planifier, de transmettre, de faire mémoire et de concevoir le changement. Par exemple, dans les organisations, seul le temps physique, mesurable et productif, est reconnu comme légitime, tandis que le temps psychique, vécu, émotionnel, celui qui façonne la motivation, l’engagement ou la créativité, est souvent ignoré, voire nié. C’est précisément dans cette tension – entre le temps mesuré et le temps vécu, entre le visible et l’invisible – que je souhaiterais inscrire ma réflexion. Je peux aussi bien l’inscrire en prenant pour exemple l’école.
Le système scolaire en Afrique illustre clairement cette dissonance temporelle. Largement hérité du modèle colonial, tant dans sa forme que dans ses contenus, il s’est instauré en rupture avec les traditions éducatives locales. Dès les années 1950, l’idée d’un apprentissage en langue maternelle est défendue pour ses bénéfices cognitifs, identitaires et didactiques. Mais ce n’est qu’à partir des années 1980-90 que des campagnes en faveur de l’enseignement des langues nationales sont véritablement lancées, souvent sans les résultats espérés. Les raisons sont multiples : langues coloniales perçues comme vecteurs de réussite, faiblesse des dispositifs de formation, manque de ressources, résistances politiques et symboliques. À Djibouti, malgré une volonté affichée, cette expérimentation n’a jamais été menée, tant les défis didactiques, organisationnels et sociolinguistiques sont jugés complexes. Interroger cet écart – entre la temporalité du modèle éducatif colonial et celle des dynamiques culturelles locales – permettrait de mieux comprendre pourquoi certaines réformes échouent ou restent à l’état de projet. C’est également à cet endroit, entre temps imposé et temps vécu, que pourrait se situer ma contribution à ce programme.
« Recherche en linguistique et milieu entrepreneurial »
Intervention autour des « expressions, usages et représentations » de l’axe 3 de votre unité de recherche, en m’appuyant sur une approche appliquée et contextualisée dans le monde de l’entreprise. À partir de mon expérience de terrain et de l’observation directe des interactions professionnelles, il apparaît que la réception et la gestion des émotions jouent un rôle structurant dans la qualité des échanges interpersonnels, dans la dynamique des équipes et plus largement dans le climat organisationnel. L’émotion y est à la fois un liant et un déliant. En effet, si elle peut renforcer la cohésion, elle devient tout aussi souvent facteur de tension, de désengagement ou de rupture. C’est ce pouvoir déliant qui mobilise tout particulièrement les dispositifs de régulation mis en place par les entreprises : formations à la gestion des émotions, coaching, développement du leadership émotionnel. On pourrait évoquer comment à travers cette régulation des émotions dans les interactions, l’idéal se construit avec de l’« émotion unique », celle de l’émotion positive.